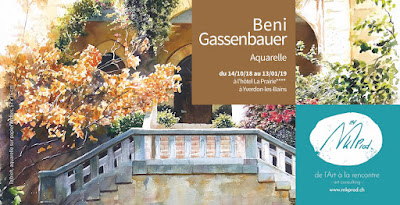Le judaïsme contemporain, entre identité et spiritualité, est au cœur de La Maison de ruines de Ruby Namdar. Un roman mis en page à la manière des vieux textes hébraïques, avec les commentaires en marge pour souligner « la réalité sous la réalité ». Rencontre avec le lauréat très politique du prix Sapir 2014.......Intervciew.........
Quelle relation entretenez-vous avec la religion juive ?
J’ai ce qu’on pourrait appeler une « âme religieuse ». Je suis passionné par la religion juive, son langage, ses textes classiques. Je viens d’une famille traditionnelle ; mes parents ont tous deux émigré d’Iran pour s’installer en Israël.
Nous habitions dans un quartier où tous les enfants étaient non religieux, et nous étions « traditionnels », dans le sens où il y avait un certain sentiment religieux dans notre famille, mais sans être nous-mêmes soumis à une observance stricte.
Dès mon plus jeune âge, lorsque nous allions à la synagogue (ce qui arrivait rarement), j’étais absorbé par les livres de prières, je les trouvais fascinants ! Je n’étais jamais rassasié de cet hébreu ancien et mystérieux ! Cela m’a pris comme une fièvre, et ne m’a jamais quitté depuis.
Beaucoup de lecteurs comparent le style de votre livre avec celui d’auteurs de l’ « école juive new-yorkaise », comme Saul Bellow, Paul Auster ou encore Philip Roth. Ces auteurs vous ont-ils influencé ?
Ils m’ont bien sûr influencé, et ce livre est en partie un hommage à ces auteurs. Je les ai, pour la plupart, découverts à mon arrivée à New York en 2000. Mais, bien qu’ils m’aient influencé, je reste très différent de ces auteurs en tant que juif et écrivain.
Je n’ai pas été élevé comme un juif américain à New York ; mes parents viennent d’Iran, j’ai grandi en Israël, ce n’est pas la même réalité. De plus, ils écrivent en anglais, tandis que j’écris en hébreu.
En réalité, l’auteur qui m’a le plus influencé est l’écrivain israélien Shai Agnon (ou Shmuel Yosef Agnon, 1888-1970), d’après-moi le plus grand écrivain hébraïque moderne.
Son hébreu est empreint de réminiscences de l’hébreu ancien, hassidique, de la Mishna [recueil de commentaires traditionnels de la Loi écrite et de décisions rabbiniques, ndlr] . Son écriture m’a beaucoup marqué car il y a de fortes influences européennes et son hébreu est unique.
L’autre écrivain de langue hébraïque qui m’a beaucoup influencé est Amos Oz. La critique dithyrambique qu’il a faite de mon livre m’a énormément touché. Le mélange entre la beauté de la langue et le fait de révéler les ténèbres du « soi » m’a laissé une forte impression.
Ayant grandi à Jérusalem dans les années 1970 et 1980, je lisais aussi beaucoup de littérature européenne : les écrivains russes, allemands, français… Une autre œuvre m’a beaucoup marqué dans ma compréhension du folklore mythologique : Héliogabale ou l’Anarchiste couronné d’Antonin Artaud (1934). Ce récit complètement fou retrace le court règne de l’empereur romain Héliogabale (218 – 222) dans ce qui apparaîtra comme l’un des épisodes les plus étranges de l’histoire romaine.
Venu de l’Est, il se met à dos les puissants de l’Empire par ses rituels païens et ses pratiques orgiaques empreintes de mysticisme. C’est une histoire fantastiquement religieuse remontant aux sources cachées du paganisme. Ce livre m’a tout simplement happé et j’y ai compris de nombreuses choses sur mon propre héritage culturel. Il m’a fait comprendre mieux qu’aucun autre livre la mythologie du Temple de Jérusalem, bien qu’il ne soit jamais évoqué dans le récit d’Artaud.
Je connaissais vaguement l’histoire du Temple, mais les juifs d’aujourd’hui sont déconnectés de sa réalité mythologique. Et en lisant l’abstraction poétique qu’Artaud fait du paganisme, j’ai commencé à intégrer cette nature mythologique et surnaturelle du Temple. C’était il y a quinze ans, l’idée a fermenté… et j’en ai fait un livre.
Au fil du récit, on devine une réflexion sur la métempsychose. Pourquoi avez-vous choisi de donner une place à la transmigration des âmes après la mort vers un nouveau corps ?
Beaucoup de gens ne réalisent pas que la métempsychose est un thème majeur dans les divers courants de la religion juive.
Tous ne s’accordent pas sur cette notion, mais le hassidisme ou la kabbale, par exemple, lui font une grande place.
Lorsqu’on parle de réincarnation dans le monde occidental, on pense tout de suite à l’hindouisme ou au bouddhisme ; pourtant, la métempsychose est aussi une réalité pour l’Occident, par la présence juive en Europe ! Beaucoup de juifs eux-mêmes ne réalisent pas que la réincarnation fait partie intégrante de nombre de courants du judaïsme.
L’idée de la réincarnation m’intéresse beaucoup, elle me fascine et j’ai voulu essayer de la traiter artistiquement dans cet ouvrage. Pas seulement en tant qu’idée religieuse, mais aussi en tant qu’idée séculière, non religieuse : je suis séduit par l’idée que notre histoire ne commence pas par notre naissance ni ne finit avec la mort.
Culturellement, notre sujet ne commence pas avec nous-même : on nous a transmis une pensée, et on la transmet à notre tour, dans un océan de pensées. La vie de la pensée ne dépend pas du cerveau, qui n’est qu’un réceptacle d’une conscience plus large.
Ainsi, lorsque je parle de transmigration de l’âme, je parle en effet d’une notion religieuse grisante ; mais elle est au moins aussi excitante et attirante comme pensée séculière, non religieuse.
Je ne pense pas que ce livre soit écrit pour des personnes exclusivement religieuses ou non religieuses ; je pense que le cœur du propos de ce récit est ouvert. Ce n’est pas un manifeste religieux, ni un manifeste d’une spiritualité non religieuse.
Mon message est plus psychanalytique que religieux, et plus jungien que freudien en l’occurrence. Si l’on me demande si ce roman est «religieux», je dirais que oui ; et si l’on me demande si c’est un roman « non religieux », je dirais aussi que oui, assurément.
Mais si l’on me demandait de choisir l’un ou l’autre, je m’y refuserais, car je pense que la force de ce récit est d’être les deux à la fois. Et cette dualité, en tant que juif, ne me dérange pas, je l’admets tout à fait.
Quel rôle jouent les extraits du Seder Ha-Avodah et du Talmud dans le récit ?
Il s’agit d’une sous-intrigue qui est comme une ombre, un reflet de l’intrigue principale. Elle n’a, en apparence, aucun lien avec la vie d’Andrew Cohen, mais en réalité elles sont une même histoire.
Le Seder Ha-Avodah, ou Ordre du Rituel, fait partie de la prière de Yom Kippour, le Grand pardon, le jour le plus solennel de l’année pour les juifs. Durant ce jour, à l’époque du Temple de Jérusalem, le haut-prêtre, ou Cohen Gadol, conduisait un ordre rigoureusement précis de rituels.
Mais à la moindre erreur, tout le rituel n’a plus la moindre valeur ; n’ayant pas obtenu le pardon pour ses péchés de l’année écoulée, le peuple d’Israël se retrouverait alors exposé au mal, sans la protection de Dieu.
Il y a donc d’un côté ce récit ancien, pétri de croyances, et de l’autre la vie on ne peut plus contemporaine d’Andrew Cohen, à New York. J’ai pris la décision de cette mise en page si particulière, rappelant les vieux ouvrages hébraïques, avec les textes en marge en haut, en bas, sur les côtés… pour créer un magnétisme bipolaire entre le texte rituel ancien et le roman contemporain ; cette mise en page donne une dimension esthétique au texte qui permet de comprendre qu’il existe une réalité sous la réalité, et cela fait partie de l’expérience du lecteur.
J’ai fait en sorte qu’on puisse ne pas lire ces passages tout en conservant une expérience littéraire complète. Mais ceux qui feront l’effort de se pencher sur ces paragraphes auront accès à une compréhension plus complexe du récit.
Que cherchez-vous à dire dans ce roman sur le judaïsme contemporain ?
Ce livre étudie la condition juive contemporaine, au sein du monde occidental dans lequel la religion devient un phénomène marginal.
Si, dans le reste du monde, l’écrasante majorité de la population reste religieuse, dans les mégalopoles occidentales, l’appartenance religieuse est en recul. Pourtant, la religion est toujours là, elle prend d’autres formes et si on essaie de la réprimer, elle revient sous la forme d’un fondamentalisme exalté. La question du judaïsme moderne est encore plus complexe car, en plus du changement de perspective, les juifs sont une minorité.
Nous sommes une minorité culturelle, et dans le cas où l’on n’est pas croyant, il devient difficile de maintenir une identité culturelle, sachant que cette identité est intrinsèquement liée à une conception religieuse. Comment puis-je être juif si je ne suis pas religieux ?
C’est la grande question. Le judaïsme n’est pas seulement une religion : c’est aussi une culture, une civilisation.
Pourtant, on ne peut séparer l’amour de la culture juive de l’amour de la religion.
Nul besoin d’être religieux pour savourer les textes classiques de la littérature hébraïque, mais l’élément religieux est bien là ! Cette difficulté du dénominateur religieux pose problème aujourd’hui dans la conception d’une identité juive. Et cette crise de l’identité est au cœur de l’État d’Israël. Beaucoup d’Israéliens pensent qu’ils ont résolu ce « problème » de l’identité : maintenant qu’Israël est un État, ils pensent que le judaïsme est une nationalité et que tout est réglé. Sauf que, non, ça ne fonctionne pas comme ça !
Ils n’ont pas résolu le problème, car il n’y a pas de problème, à part cette question autour de l’identité que je trouve magnifique !
C’est cette question que j’essaie de poser dans ce roman. Mais à aucun moment je n’ai voulu donner de réponse, car je ne pense pas qu’il y en ait une.
Comment avez-vous réagi à l’annonce de votre prix Sapir en 2014 ?
Avec ma nuit de noces et la naissance de mes filles, c’est le moment le plus important de ma vie. C’était incroyable qu’on décide de me décerner la plus haute distinction littéraire israélienne.
On m’a dit de ne pas me faire de faux espoirs, étant donné que je vis aux États-Unis et que c’est un prix au poids très politique. Et dans le cas où on me le décernerait, je deviendrais la proie de la droite israélienne : « Vous décernez le prix à quelqu’un qui vit à New York ?
Vous êtes cinglés ou quoi ? » (rires). Et finalement, j’ai reçu le prix : c’était énorme, je ne m’y attendais absolument pas, il y avait tant de bons auteurs en compétition que c’était inespéré.
Et puis quelques semaines plus tard, sous la pression politique, ils ont changé les conditions de nomination.
Ils ont modifié les règles de manière à ce que les seuls auteurs à pouvoir être nominés pour le prix Sapir soient des auteurs de langue hébraïque vivant en Israël.
Que pensez-vous de cette décision ?
Je pense que c’est une terrible erreur. C’est la preuve d’une grande insécurité de la part du gouvernement israélien : c’est exclure tous les auteurs de langue hébraïque issus de la diaspora. Ce gouvernement de droite, que je ne soutiens absolument pas, n’est pas sûr de lui, de son identité, et ne cesse de se « ghettoïser ».
« Ceux-là ne sont pas assez israéliens ! Ceux-ci ne sont pas assez juifs ! », disent-ils. Or les Israéliens et les juifs de la diaspora ne sont pas en compétition, ce sont des partenaires ! Une semaine après qu’on m’ait décerné le prix, le consul israélien à New York a organisé un banquet en mon honneur ; dans son discours, il explique que la décision de me décerner le prix était la preuve d’une grande maturité de la part de l’ establishment culturel israélien.
Et puis, une semaine plus tard, ils ont changé les statuts !
Quelle hypocrisie. On m’a bien fait comprendre que c’était parce que j’avais obtenu le prix Sapir.
Je suis donc passé du plus grand moment de reconnaissance de ma carrière à une attaque personnelle, chargée de considérations politiques.
Source Le monde des religions
Vous nous aimez, prouvez-le....